Le courage de la liberté
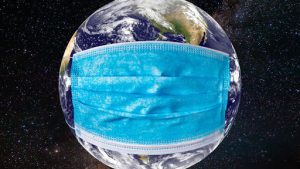
« Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement », écrivait au XVIIe siècle La Rochefoucauld dans ses Maximes. Il est intéressant de noter que l’écrivain s’interroge sur ces deux notions qu’il met en parallèle à une époque où l’idée de la mort est pourtant extrêmement apprivoisée. Avoir une « belle mort », au XVIIe, ce n’est pas simplement avoir le temps de dicter ses volontés et de mettre en ordre ses affaires. Il s’agit de « se reconnaître », c’est-à-dire de prodiguer des conseils à ses descendants et surtout de se confesser ; en résumé, c’est se mettre en paix avec Dieu et avec les hommes. La comparaison avec aujourd’hui est stupéfiante. Une « belle mort », de nos jours, c’est s’éteindre rapidement, de préférence dans son sommeil, mais surtout sans se rendre compte que l’on passe de vie à trépas. On ne s’interroge plus sur la possibilité de regarder ou non la mort fixement, ce qui signifiait sous la plume de La Rochefoucauld que l’on ne pouvait l’envisager ou la percevoir que par l’effet miroir de celle d’autrui, puisqu’un vivant, par définition n’est jamais mort. Or de nos jours, on ne veut même plus la voir du tout. Peu de gens meurent volontairement à domicile, on ne veille plus les morts sauf dans les campagnes, on n’assiste plus à la mise en bière et les dispositions gouvernementales interdisant d’enterrer convenablement nos morts lors des confinements montrent que cela n’est pas perçu comme « essentiel ». Le jeunisme nous voudrait perpétuellement jeunes et ce que l’on nomme « le progrès » nous envisagerait presque éternels.
On aboutit ainsi à une société déconnectée du réel où mourir à 93 ans est devenu un scandale.
Cette dérive est dangereuse, car le corollaire de ce fantasme est que tout ce qui est de nature à nous ramener à l’évidence est refusé avec effroi. Le SARS COV-2 touche en majorité les personnes âgées. La moyenne d’âge des décès est de 85 ans. Aussi difficile que cela puisse être lorsque des proches que l’on aime ont cet âge, il nous faut accepter qu’ils sont entrés dans une période de leur existence où la mort est devenue probable et qu’elle sera, à court ou moyen terme, incontournable. Si nous n’acceptons pas cette douloureuse vérité, nous aliénons notre capacité à appréhender la réalité : un éternel recommencement où l’on naît pour décéder un jour.
Ce fantasme de l’immortalité nous conduit à refuser la vie pour faire reculer la mort. « Plutôt mourir debout que vivre à genoux » écrivait Camus[1]. Il y énonce le fait que tandis que, selon Marx, le révolutionnaire a la volonté de transformer le monde, le révolté, selon Rimbaud, veut changer la vie. La révolte, théorise-t-il alors, est souvent légitime, car elle est l’expression de la liberté et qu’elle se nourrit d’espoir. Elle refuse le confort de la tyrannie et de la servitude.
Nous touchons à l’essentiel.
Voulons-nous transformer durablement notre société en une dictature sanitaire où toute notre vie ne tend qu’à la conservation d’icelle, en refusant le lien social au motif qu’il pourrait nous faire prendre le moindre risque ou allons-nous nous révolter contre cette idée et choisir de vivre libres ? Sommes-nous si forts, cachés derrière nos écrans, dans la solitude de nos appartements, tandis que se meurent les commerces qui animaient nos villes ? Souhaitons-nous survivre à genoux ? La réalité de la France, tant dans son projet collectif que pour les individus que nous sommes se résume-t-elle au chiffre des réanimations ? Nous vivons dans la peur. Celle de la Covid, celle du terrorisme. Ces deux terreurs s’additionnent pour beaucoup d’entre nous, et contribuent à faire de l’extérieur un lieu dangereux dans lequel il convient d’éviter de s’aventurer. L’autre est devenu l’ennemi, potentiellement porteur d’un virus ou d’un couteau et mieux vaut rester chez soi pour se protéger.
On a à juste titre dénoncé les propos de nos dirigeants lorsqu’ils ont accusé les Français d’avoir été inconséquents cet été et d’avoir « trop profité » de leur liberté retrouvée. On entendait dans ces propos l’esprit pétainiste de la célèbre phrase « Français, vous avez trop joui ! ». La défaite de 40 n’est pas celle des Français qui se sont battus du mieux qu’ils ont pu. C’est celle des dirigeants et de leur stratégie lamentable, de la ligne Maginot, de cette impréparation effroyable doublée d’une arrogance sans pareil.
Or, l’histoire est tragique, car elle se répète, hélas, à l’infini.
Les Français de 2020 n’ont pas été irresponsables. Durant la période estivale, le virus ne circulait plus. Et les malades d’aujourd’hui n’ont pas été infectés en août. Nous payons aujourd’hui l’impréparation de cette seconde vague et le manque total d’anticipation de l’exécutif, tant sur les réas, que sur les tests ou la prévention, que sur l’isolement des malades qui, au passage, n’est toujours pas fait.
Pour autant, fallait-il reconfiner ? Là encore, l’histoire devrait nous aider à y voir plus clair. Les antagonismes que nous rencontrons entre ceux qui voient le pays dans sa globalité, dans son chômage, sa douleur, son économie écrasée, sa dette qui explose, ses enfants en souffrance, ses jeunes sacrifiés, son seuil de pauvreté et tous les dégâts causés aussi bien pour les petits commerces que pour le monde de la culture, pour les restaurateurs qui ne rouvriront pas, pour les bars à jamais fermés, pour le nombre de suicides qui s’accroit chaque jour, pour les malades qui ne vont plus se faire soigner et de l’autre ceux qui ne regardent que la Covid, ses hospitalisations et ses réanimations, qui estiment insupportable que l’on puisse mourir de maladie, même au-delà de 85 ans, qui considèrent, au fond, la situation à court plutôt qu’à moyen ou long terme.
C’est ce même antagonisme qui opposait De Gaulle à Pétain. Tous deux ont été de bonne foi, tous deux ont pensé faire pour la France ce qui était le mieux. Mais comme l’a extraordinairement analysé Mauriac, De Gaulle songeait à la France et Pétain pensait aux Français. Ces deux attitudes peuvent s’entendre et sont éminemment respectables.
L’un voulait que la France garde sa place dans le monde, soit une grande nation, libre, victorieuse, debout. L’autre souhaitait limiter le nombre de morts, conserver les bâtiments dans les villes et l’approvisionnement. L’un est donc parti à Londres pour se battre, au risque de sa vie et de celles de ses compagnons de Résistance, l’autre a serré la main d’Hitler pour marquer la soumission des Français. L’un avait l’envergure d’un chef d’État, avec une visée à long terme pour son pays, l’autre fut, après une carrière militaire honorable, un bureaucrate qui n’envisageait que le court terme.
Nous sommes aujourd’hui à distance de cette crise à laquelle le gouvernement fait tellement souvent référence en nous rappelant que « nous sommes en guerre », que le virus est un « ennemi », qu’il y a actuellement à l’Élysée un « Conseil de défense », etc. Peut-être devrait-il, puisqu’il s’identifie à un gouvernement en guerre, se retourner sur l’histoire.
Car celle-ci nous a maintes fois prouvé que les Français ne peuvent vivre et s’épanouir que dans une France libre, en bonne santé économique et collective. C’est la seule vraie bataille qu’il nous faut gagner, encore et toujours.
De Gaulle avait compris qu’il fallait sacrifier des vies pour cela.
Or c’est justement ce qu’aujourd’hui, nous ne voulons plus faire.
Sans doute nos lendemains auront-ils un goût bien amer, car si la vie n’a certes pas de prix, la liberté en a un.
C’est celui du courage.
En aurons-nous enfin un jour, avant qu’il ne soit trop tard ?
[1] Dans l’Homme révolté, publié en 1951.